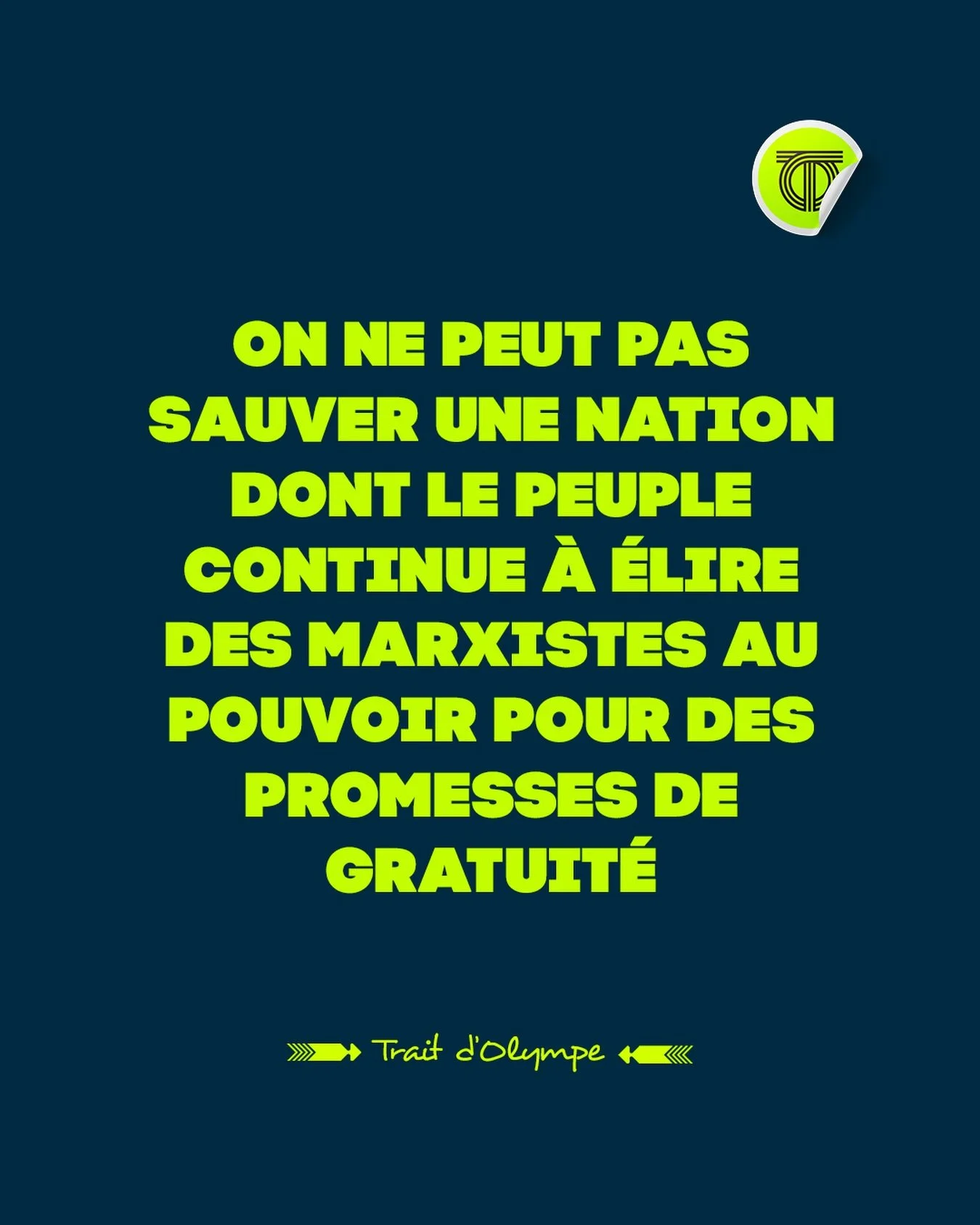MAL-ÊTRE FÉMININ : COMMENT UNE GÉNÉRATION ENTIÈRE A ÉTÉ MISE SOUS PILULE
Partout en Occident, des femmes sortent de la pharmacie avec une boîte d’antidépresseurs dans le sac. C’est devenu tellement banal que plus personne ne tique. Les médecins prescrivent, les systèmes de santé valident, l’industrie pharmaceutique encaisse. Et la question la plus simple du monde reste soigneusement évitée : qu’est-ce qui, exactement, rend les femmes si mal ?
On parle de « crise de santé mentale », de « dépression », d’« anxiété ». Les réseaux sociaux regorgent de vidéos de femmes en larmes, épuisées, dépassées. En arrière-plan, les chiffres explosent : prescriptions en hausse constante, durée des traitements qui s’allonge, et une particularité frappante : ce sont surtout les femmes qui avalent les comprimés.
Cet article ne cherche pas à culpabiliser celles qui prennent un traitement ni à nier la réalité de la souffrance psychique. Il pose une autre question, que notre époque fuit avec soin : et si la psychiatrisation massive du mal-être féminin servait surtout à masquer un modèle de société profondément dysfonctionnel pour les femmes elles-mêmes ?
1. Une génération de femmes sous ordonnance
Dans la plupart des pays riches, les antidépresseurs sont devenus aussi courants que les anti-douleurs. En Europe, la consommation a été multipliée par deux à presque deux fois et demi entre 2000 et 2020 dans de nombreux pays.
Au Royaume-Uni, les données du NHS estiment à près de 8,75 millions le nombre de personnes ayant reçu au moins un antidépresseur en 2023/24, avec une majorité de femmes, particulièrement celles de plus de 50 ans.
En Angleterre, une enquête récente montre qu’environ une femme sur six de plus de 50 ans est sous antidépresseurs depuis cinq ans ou plus, souvent de façon quasi permanente.
La tendance n’est pas marginale, elle est structurelle :
Les prescriptions ont triplé en vingt ans dans certains systèmes de santé.
Après le Covid, les courbes de délivrance ont encore grimpé, avec des millions de patients supplémentaires et une augmentation marquée à partir de 2020.
Les antidépresseurs ne sont plus un outil ponctuel pour traverser une crise. Pour beaucoup de femmes, ils sont devenus une infrastructure de vie.
2. Les adolescentes en première ligne : quand la prudence passe après la vitesse
La bascule la plus inquiétante se joue chez les plus jeunes. Dans plusieurs pays, les prescriptions d’antidépresseurs chez les adolescentes ont bondi depuis la pandémie, avec une hausse nette des délivrances chez les 12-17 ans.
Pendant ce temps, les autorités sanitaires reconnaissent noir sur blanc que les ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) augmentent le risque de pensées et de comportements suicidaires chez les moins de 25 ans. La FDA indique un risque de suicidabilité doublé par rapport au placebo, ce qui a justifié un encadré d’avertissement (« black box warning ») sur ces médicaments.
En théorie, les recommandations sont claires :
Avant de prescrire à un jeune, évaluation psychiatrique solide,
recours prioritaire à la psychothérapie,
suivi rapproché en début de traitement.
Dans la pratique, la réalité ressemble souvent à autre chose :
consultations chronométrées,
listes d’attente ridicules pour la thérapie,
pression institutionnelle pour « faire quelque chose » rapidement,
et une pilule qui finit par servir de raccourci.
Personne de sérieux ne prétend qu’aucun adolescent ne devrait jamais recevoir d’antidépresseurs. Mais transformer une génération entière en cobayes d’une stratégie pharmaceutique est une autre histoire.
3. Ce que ces pilules prennent en échange : émotions, désir, énergie
On comprend pourquoi, face à la douleur psychique, les femmes acceptent un traitement qui promet un soulagement rapide. Le problème, c’est le prix d’échange.
Les effets secondaires les mieux documentés des ISRS sont tout sauf anodins :
émoussement émotionnel, sensation de vivre « derrière une vitre » ;
dysfonctions sexuelles massives : baisse de libido, difficulté à atteindre l’orgasme, diminution du plaisir ou de la sensibilité ;
prise de poids, fatigue, insomnie ou somnolence, irritabilité, etc.
Des revues cliniques estiment que 40 à 70 % des patients sous ISRS présentent des troubles sexuels significatifs, avec des taux encore plus élevés lorsque l’on pose franchement la question plutôt que d’attendre que le patient se plaigne spontanément.
Chez les femmes, cela signifie souvent :
désir en chute libre,
difficulté à être excitée,
orgasmes raréfiés ou absents,
perte de plaisir là où il restait justement un espace de vitalité.
Pour une société obsédée par la « libération sexuelle », le paradoxe est violent : une masse de femmes médicalement traitées avec des molécules qui coupent précisément ce qui nourrit le désir, l’attachement, la sensualité.
Et ce n’est pas tout. Au moment d’arrêter, une partie des patientes fait face à des symptômes de sevrage très durs : vertiges, « chocs électriques » dans la tête, anxiété aiguë, insomnie, instabilité émotionnelle. Ce phénomène est suffisamment répandu pour que des agences de régulation aient revu récemment les notices et les recommandations de sevrage.
Cerise morbide sur le gâteau : un petit nombre de patients développent des troubles sexuels persistants après l’arrêt complet (PSSD), à tel point que l’Agence européenne des médicaments a reconnu ce risque en 2019, et que des articles récents décrivent des femmes et des hommes parlant d’une sensation de « lobotomie sexuelle ».
4. L’hypothèse du « déséquilibre chimique » s’effrite
Le discours dominant pendant des décennies tient en une phrase simpliste :
« Vous êtes déprimée parce que votre cerveau manque de sérotonine. »
Cette hypothèse monoaminergique a servi de base marketing et explicative à la génération d’ISRS. Sauf que les données se sont progressivement retournées contre ce récit trop confortable.
Une méta-analyse dirigée par le psychologue Irving Kirsch, basée sur des essais soumis à la FDA, a montré que la différence entre antidépresseur et placebo est en moyenne faible et souvent en dessous du seuil de pertinence clinique, surtout pour les dépressions légères à modérées.
En clair :
une grande partie du bénéfice ressenti par les patients dépend de l’effet placebo,
et les médicaments ne se distinguent nettement du placebo que chez les cas les plus sévères.
D’autres travaux confirment l’idée que l’effet placebo peut représenter jusqu’à 70–80 % de la réponse globale au traitement antidépresseur.
Ce constat n’implique pas que les antidépresseurs soient « inutiles » ou qu’il suffirait de « penser positif ». Il pose plutôt deux questions dérangeantes :
Pourquoi a-t-on construit un storytelling chimique simpliste que la science contredit aujourd’hui en grande partie ?
Pourquoi met-on autant d’énergie à défendre ce modèle, plutôt qu’à reconnaître que la souffrance psychique est liée à un environnement social, relationnel, culturel qui dysfonctionne profondément ?
5. Nous n’avons pas médicalisé que la souffrance : nous avons médicalisé la solitude
Quand on parle du mal-être des femmes, on le réduit souvent à des circuits neuronaux. On parle beaucoup moins de ce qui s’est effondré autour d’elles.
Les données sur la solitude sont brutales. Le rapport de la Commission de l’OMS sur la connexion sociale estime qu’une personne sur six dans le monde vit dans une solitude marquée, avec un pic chez les adolescents et les jeunes adultes.
Au Canada, près d’une jeune femme sur trois (15–24 ans) déclarait se sentir souvent ou toujours seule dès 2021.
La même solitude est fortement corrélée à l’anxiété et à la dépression : aux États-Unis, une étude récente montre que 81 % des adultes se déclarant très seuls souffrent aussi de troubles anxiodépressifs, contre 29 % seulement chez ceux qui se sentent moins isolés.
Et que fait notre société face à cette isolation de masse ?
On ferme des lieux de sociabilité,
on remplace les communautés par des flux numériques,
on réécrit les vies autour de l’individu autonome, auto-suffisant, « empouvoiré »… et profondément seul.
Le problème, ce n’est pas le cerveau des femmes. C’est d’avoir remplacé des tissus relationnels, familiaux, religieux, associatifs par du vide connecté.
6. Hookup culture, sexe sans lien et malaise féminin
On a vendu aux femmes un deal très spécifique :
« Sois libre comme un homme dans ta sexualité, sans attaches, sans honte, et tu seras heureuse. »
La fameuse hookup culture – rencontres éphémères, partenaires interchangeables, intimité désincarnée – est présentée comme une conquête féminine. Sauf que les données, là aussi, sont moins glorieuses.
Des études sur les étudiants et jeunes adultes montrent que la multiplication de relations sexuelles sans engagement est fréquemment associée à davantage de symptômes d’anxiété, de dépression, de regret et de baisse d’estime de soi, en particulier chez les femmes.
Les résultats ne sont pas monolithiques :
certaines personnes vivent ces expériences de façon neutre ou positive,
mais pour beaucoup, surtout quand la motivation n’est pas réellement choisie (pression sociale, peur de rester seule, validation narcissique), les conséquences psychiques sont franchement négatives.
Or cette culture du sexe « détaché » se heurte frontalement à la manière dont un grand nombre de femmes vivent le désir :
besoin de se sentir en sécurité,
importance du lien émotionnel,
attachement renforcé par l’intimité.
On a donc :
Un discours normatif qui valorise la performance sexuelle détachée,
Des corps et des psychismes féminins qui, souvent, n’encaissent pas ce modèle sans dégâts,
Et derrière, des symptômes étiquetés « dépression » ou « anxiété », soignés par… ISRS.
On ne soigne pas une blessure affective avec une molécule qui coupe le désir et l’émotion. On l’anesthésie.
7. Féminisme, productivisme et effacement des instincts nourriciers
Le féminisme dominant des dernières décennies a martelé trois messages principaux :
« Tu n’as besoin de personne »,
« Ta valeur se mesure à ta carrière »,
« La dépendance affective est une faiblesse. »
Résultat : des millions de femmes se retrouvent prises entre ce script idéologique et leurs propres désirs : avoir une famille, se consacrer à des relations profondes, être présentes pour leurs proches, construire quelque chose de stable.
Non, toutes les femmes ne veulent pas se marier ni avoir des enfants. Mais parmi celles qui le souhaitent, la marche est devenue de plus en plus compliquée :
marché amoureux fragmenté,
défiance entre sexes,
instabilité relationnelle,
banalisation de la rupture.
Dans ce contexte, ce qui aurait dû être un environnement naturel de déploiement pour la féminité (famille solide, communauté, liens continus) ressemble de plus en plus à une anomalie statistique. Le reste du temps, on demande aux femmes de :
performer au travail,
gérer seules la charge mentale,
rester souriantes, indépendantes, flexibles,
et surtout ne jamais admettre qu’elles sont épuisées par ce modèle.
Quand le corps finit par lâcher sous forme d’angoisse, de fatigue chronique, de dépression, on appelle ça un « trouble » individuel plutôt qu’un signal de saturation collective.
8. Médicaments & identité : quand le traitement devient un marqueur social
Sur les réseaux, on voit fleurir les posts où l’on célèbre son « anniversaire de sertraline », son « parcours Prozac », ses « updates d’ISRS ». Le traitement n’est plus seulement un outil thérapeutique : il devient un élément d’identité, une sorte de drapeau de survie moderne.
Ce glissement n’est pas anodin :
il normalise un état où être sous psychotropes devient la norme,
il détourne le regard des causes structurelles,
il rend suspecte toute interrogation sur cette médicalisation du quotidien.
Pendant que l’on se moquait des femmes des générations précédentes soi-disant « dépendantes » de leur mari ou de leur famille, on a fabriqué une autre forme de dépendance, plus propre, plus silencieuse, estampillée scientifique. Mais la logique reste la même :
Tu te sens mal ? Ne change surtout pas le système. Prends quelque chose pour continuer à y survivre.
9. Ce que cet article ne dit PAS
Pour éviter les contresens ou les incompréhensions, mettons les choses au clair :
Certaines femmes doivent, pour des raisons médicales sérieuses, prendre un antidépresseur, parfois longtemps. Pour des dépressions sévères, des troubles récurrents, ça peut sauver des vies.
Arrêter brutalement son traitement sans avis médical est dangereux. Toute décision concernant les médicaments doit se prendre avec un professionnel compétent, pas avec un article de blog, aussi énervé soit-il.
Je ne dis donc pas de jeter vos pilules. Je dis plutôt qu’il faut se demander pourquoi autant de femmes en ont besoin pour supporter la vie qu’on leur propose. La nuance est là.
Conclusion : cesser de maquiller une détresse structurelle en « déséquilibre individuel »
Ce qui se joue n’est pas un simple débat médical. C’est un choix de société.
On peut continuer comme aujourd’hui :
pathologiser le mal-être féminin,
coller une étiquette de trouble mental sur chaque souffrance,
prescrire à la chaîne pour éteindre les symptômes,
ignorer la solitude de masse, la marchandisation des relations, la sexualité déracinée, la disparition des communautés, la pression productive qui écrase.
Ou on peut commencer à admettre que si autant de femmes ont besoin de molécules pour simplement tenir debout, ce n’est peut-être pas elles le problème, mais le monde qu’on a construit autour d’elles.
Recréer des liens réels, revaloriser les relations stables, accepter que la féminité ne se réduit pas à une performance de carrière, remettre des limites à une culture sexuelle sans frein, redonner un cadre moral clair, faciliter l’accès à des thérapies de qualité… tout cela demande beaucoup plus d’effort que signer une ordonnance. Mais c’est à ce prix que l’on sort de la logique du pansement chimique posé sur une fracture sociale.
Parce qu’à force de traiter les femmes comme des cerveaux à corriger chimiquement, on oublie une chose simple : si une génération entière de femmes a besoin d’être anesthésiée pour supporter le quotidien, ce n’est pas leur chimie qu’il faut d’abord réparer, c’est notre civilisation qui a fait le choix de faire des femmes des copies des hommes. Ce qui donne d’ailleurs une augmentation significative des maladies cardio-vasculaires chez les femmes, qui jusqu’ici arrivaient beaucoup plus aux hommes.